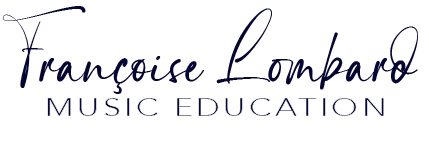L’ÉCOUTE INTÉRIEURE base de toutes les pédagogies
Françoise Lombard
La rythmique Dalcroze m’accompagne depuis ma petite enfance dans un lien affectif puissant. À l’Institut de Genève, je me sentais faire partie d’une grande famille qui évoluait dans un monde de musique, de mouvement corporel et de créativité tellement naturel et intégré à ma vie que j’ai pris du temps à réaliser tout ce que cet univers dalcrozien avait inscrit de particulier dans mon ADN de musicienne et de pédagogue. J’ai eu beaucoup de chance de bénéficier d’une telle source d’épanouissement.
Néanmoins, il m’a fallu prendre un jour du recul pour aller découvrir d’autres horizons et d’autres manières d’aborder la musique et l’humain pour enrichir ma recherche.
Au fil de mes diverses formations comme musicienne et pédagogue je n’ai cessé de chercher à mieux intégrer la dimension de l’écoute, fondement de toute forme de communication ; une écoute consciente, présente et toujours en mouvement.
Le mouvement de l’écoute
Dans la Pédagogie de l’Écoute, j’ai trouvé des outils concrets pour me connaître davantage et pour travailler de manière tangible sur mon écoute. J’ai compris par l’expérience interpersonnelle ce qu’était une écoute en mouvement et la place déterminante que celle-ci occupe dans toute pédagogie et dans la vie en général.
Une écoute vivante et présente est par définition une écoute en mouvement. Ceci signifie qu’elle recueille et relie entre elles les sensations physiques et psychiques, en passant par les émotions et les pensées du moment. Grâce aux canaux semi-‐circulaires de l’oreille interne nous captons les sons et les bruits dans tout l’espace. Idéalement, l’écoute est donc en mouvement et libre, assurant un échange permanent entre le monde intérieur et le monde extérieur. Cependant, nous portons tous une histoire et des mémoires qui l’ont conditionnée : elle a souvent été bloquée par des peurs ou des événements traumatisants, figée dans des réflexes de protection ou d’anticipation, confinée dans des habitudes, des préjugés ou autres barrières. Par conséquence, notre écoute a perdu une part de sa mobilité, pour diverses raisons propres à chaque être humain, nous privant de ce qu’elle a de plus précieux : sa présence. Sans cette qualité de présence, le contact conscient et global avec le corps disparaît.
C’est ainsi que dans un cours de solfège, il arrive qu’en début de dictée, l’élève capte uniquement les premiers sons, parce que surgit soudain un souci concernant le rythme, qui l’empêche d’être réceptif aux sons suivants. Le blocage apparaît parfois dès le début de la dictée, l’élève étant persuadé de manquer de talent musical pour réussir à entendre et à noter ce qu’il a entendu. Et ceci même après avoir chanté de nombreuses mélodies, marché et frappé des rythmes et fait des exercices rythmiques variés sur des pièces musicales.
L’écoute a donc besoin de retrouver sa capacité de liberté.
Cela nécessite de prendre le temps de se réapproprier ses sensations corporelles pour habiter son corps et reprendre confiance en soi. Une écoute en mouvement donne une sensation simultanée d’ouverture et de disponibilité en soi et autour de soi. Elle génère du plaisir et du bien‐être.
La mise en mouvement de l’écoute
Voici un exercice destiné à développer la mise en mouvement de l’écoute :
Debout en cercle, on commence par produire un unisson qu’on fait durer le temps nécessaire pour installer une bonne qualité d’écoute à soi et au groupe. Chacun laisse ensuite sa voix moduler à son gré. Une seule consigne : s’écouter et écouter les autres. On a la possibilité de se déplacer les yeux ouverts ou fermés, de chercher du contact ; on savoure la liberté de se joindre momentanément au son de quelqu’un d’autre, ou de créer une dissonance, une consonance, tout ceci au gré de son envie, en participant sans contrainte à ce tableau sonore. On se laisse guider par ce qui nous fait du bien. On reste toujours attentif à la sensation de la vibration de sa voix et de celles des autres qui résonnent aussi en nous. La bouche ouverte, dans une nuance variant du pianissimo au forte, on apprivoise petit à petit le phénomène de la page blanche sur laquelle se déroule une composition vivante collective guidée par une écoute commune. On ne donne pas de consigne concernant la fin de l’exercice : c’est encore l’écoute de tous qui la définit spontanément.
Les témoignages sont souvent très riches : les musiciens professionnels éprouvent souvent une sensation de liberté : l’absence de consignes et de contraintes (partition ou autre) ramène l’individu à son corps et à ses sensations et délie ses oreilles. Sans attente particulière de résultats, on se dégage de la crainte du regard des autres et l’écoute, libérée d’entraves psychologiques, retrouve sa confiance et sa capacité de mobilité.
Des exercices de ce type ont besoin d’être souvent répétés.
Ils seront vécus chaque fois différemment, le contexte temporel et relationnel n’étant jamais le même.
Entre l’enseignant et les élèves
Chaque nouvelle situation étant différente, nous appréhendons ensemble l’inconnu, avec la fragilité que cela implique. Je pose volontiers des questions à mes élèves sur l’effet des divers exercices proposés ; l’être humain est complexe et les chemins pour apprendre sont personnels à chacun ; leurs réponses, parfois inattendues, souvent variées, m’éclairent. Pour favoriser l’émergence, l’épanouissement et l’expression du monde intérieur des élèves, l’enseignant a la responsabilité de créer un cadre sécurisant dans lequel l’élève va être invité à prendre sa place, à sa manière. Au niveau de la relation, on doit établir un lien de confiance avec nos élèves, sachant que l’ouverture de leur écoute en dépend. Ce cadre doit également être adapté aux besoins de l’enseignant qui doit assurer son confort pour se sentir à l’aise dans son enseignement.
La place de l’écoute dans la pédagogie dalcrozienne
La pédagogie dalcrozienne évolue dans différentes sphères mais quelle que soit l’orientation qu’on lui donne, l’écoute en est toujours la base. La variété des approches et la place accordée à la créativité des enseignants Dalcroze offrent à chacun des portes d’entrées diversifiées vers les langages musical et corporel. C’est un terrain pédagogique fertile qui offre aux étudiants la possibilité de résonner, chacun dans sa différence. Car il s’agit bien de faire résonner des richesses ou des talents qui existent déjà; de faire éclore et de développer des possibles en dormance.
On peut remarquer en rythmique que le fait de mettre son corps en mouvement ne suffit pas nécessairement pour incarner la musique. Si le mouvement musculaire associé à la musique peut favoriser la sensation de l’espace et du mouvement musical, il ne garantit pas que l’élève aura été touché par la musique et que celle‐ci vibrera réellement dans son propre espace intérieur.
A-t-il eu assez de temps et d‘espace d’écoute pour laisser résonner la musique DANS son corps ? Peut-il vraiment ressentir profondément la musique si celle-ci n’a pas pu résonner consciemment en lui ?
En solfège, on constate que le fait de chanter les sons de la gamme compris dans un intervalle, pour mieux le reconnaître, ne garantit pas de sentir physiquement la réelle distance séparant les deux sons ; ce qui laisse parfois encore planer des doutes dans le déchiffrage vocal ou la dictée.
En harmonie, la relation entre les sons d’un accord ou la relation entre plusieurs accords qui se succèdent est un monde à découvrir en résonance avec son espace intérieur. Lorsqu’on laisse vibrer les sons des accords chantés dans tout le corps, on vit l’harmonie musicale comme une enfilade d’impressions et de sensations qui nous font voyager dans des paysages intérieurs aux reliefs riches en émotions, nuances ou contrastes. Là encore, chacun les ressent et les vit à sa manière. La mise en mouvement de la sensibilité (emovere lat. émouvoir) va créer spontanément le sens du phrasé.
Ces « bains de sons » donnent à l’oreille des repères corporels sécurisants et sont un important prélude à l’analyse harmonique. Sans cet éveil intérieur, les successions d’accords peuvent paraître plus neutres ou théoriques.
Cette évolution vers la bioacoustique, la neuropsychologie et les sciences de l’affectivité s’inscrit à mon sens dans une continuité logique de ce que Dalcroze a élaboré.
Un solfège enraciné dans le corps
Dans divers articles, j’ai déjà eu l’occasion de parler des liens qu’on peut établir entre la Rythmique Dalcroze et la Pédagogie de l’Écoute, et de l’importance de la dimension affective dans l’enseignement de même que dans toute forme d’apprentissage.
J’aimerais proposer aujourd’hui quelques exercices que l’on peut facilement intégrer dans l’univers dalcrozien.
Pour reconnaître la hauteur des sons et la relation entre eux, voici une progression d’exercices réalisables en groupe ou à deux :
- « Faire l’ascenseur », c’est à dire faire glisser sa voix du plus grave au plus aigu et inversement, la bouche fermée (pour sentir clairement le mouvement du son dans le corps) puis la bouche ouverte. On le fait en un seul souffle dans une direction, ou on reprend de l’air au milieu du trajet si nécessaire ; on insiste sur l’écoute de la sensation du son qui se déplace dans un mouvement continu le long de la colonne vertébrale. On essaie de ne pas « sauter des étages ».
- La bouche fermée, tout le groupe émet un même son ; puis la moitié du groupe suit l’enseignant sur un autre son (commencer par la 5te ou la 3ce) pendant que l’autre moitié reste sur le premier son. Faire durer chaque son (on reprend son souffle quand on en a besoin, sans jamais forcer la durée de l’expiration) pour bien sentir ce qui se passe. Quelle sensation est reliée à cet unisson ? à l’intervalle ? Est-ce que les sons des autres vibrent aussi dans mon corps ? L’expérience sensorielle et relationnelle de l’unisson n’est pas la même que celle de deux sons distincts et la plupart du temps, tout le monde s’entend sur ce point. Quant à l’intervalle, il s’inscrit sous forme de deux sensations de hauteurs différentes dans le corps et d’une distance qui les sépare. À force de revenir sur ce type d’expérience, la perception corporelle de ces points de repères devient un support de plus en plus fiable pour l’oreille.
On peut faire la même expérience avec tous les intervalles : partir de l’unisson, créer l’intervalle et revenir à l’unisson. Faire vivre aux deux parties chacun des rôles: celui de rester sur le son fondamental et celui de créer l’intervalle et de revenir à la base. Inviter les élèves à s’exprimer sur leur vécu pour les aider à devenir conscients de ce qu’ils vivent et à se l’approprier.
- Maintenir la teneur d’un son fondamental pour bâtir des tricordes, tétracordes, pentacordes et gammes complètes, ainsi que pour chanter des chansons simples sans modulations. Le rapport horizontal des sons de la mélodie est enrichi du rapport vertical avec la tonique, ce qui consolide l’intonation. On apprivoise le frottement des secondes (qui revient souvent quand on quitte et revient à la tonique dans un mouvement mélodique conjoint) et on développe l’habitude de se fier aux sensations corporelles autant qu’à l’oreille. Cette participation active du corps donne une assise nouvelle et crée souvent beaucoup de joie à la personne qui se sent retrouver un certain pouvoir et une confiance dans ses capacités.

- Créer trois groupes dont deux maintiennent une teneur (fondamental et 5te) et le troisième se promène par tons ou demi-tons entre les deux, sous la direction de l’enseignant ou d’un élève ; faire une rotation entre les groupes pour que chacun vive l’expérience sous toutes ses formes.

- Maintenir ensuite seulement une teneur (d’abord la voix du bas, puis celle du haut ou du milieu) et faire bouger les deux autres voix simultanément ou consécutivement par tons ou demi-tons.

- Puis faire bouger par tons ou demi-tons les trois voix. La consigne est de rester sur le son aussi longtemps qu’on n’a pas reçu l’indication de le quitter vers le haut ou le bas.

- Cet exercice fait vivre l’étroite relation entre la résonance des sons et la résonance des personnes entre elles. Les changements de paysages harmoniques sont d’autant plus touchants qu’on les vit et les partage avec tout son être.
L’influence de notre écoute sur celle de nos élèves
Pour qu’ils s’investissent totalement dans leur écoute, nos élèves ont besoin d’entrer en contact avec notre présence.
Mon professeur de piano au Conservatoire de Genève Louis Hiltbrand notait : « Diriger implique une disponibilité, c’est voir le mouvement de la vie (relation entre les sons) aussi bien en nous qu’en-dehors de nous. Regarder, écouter, sentir. » (Louis Hiltbrand,113)
Il y a là une notion d’espace et de calme à trouver en soi ; une disponibilité pour accueillir l’autre dans ses particularités et dans sa différence ; une confiance dans son écoute pour rester intérieurement en mouvement, pour se laisser toucher par ce qui se passe dans le cours et en même temps cadrer chaque situation de manière adéquate.
Louis Hiltbrand disait aussi : « Écouter, c’est parler avec le silence. » (Louis Hiltbrand, 141)
Il m’avait raconté que petit enfant, il se mettait devant son piano, écoutait le silence, jouait un son puis l’écoutait retourner au silence.
Ce n’est pas facile de trouver du silence en soi. Nos pensées souvent bruyantes et agitées sont encombrantes. Les élèves arrivent avec une disposition d’écoute déjà conditionnée par divers types d’apprentissages – sauf peut-être les tout-petits – et de contextes de vie, et nous sommes là avec nos propres habitudes d’enseignant.
Il se trouve que les exercices d’écoute que nous proposons dans l’enseignement nous font participer autant que nos élèves et nous aident aussi beaucoup à cultiver cet espace intérieur.
Tisser des liens et trouver sa place
En cercle, debout ou assis, chacun à son tour, en commençant par l’enseignant, émet un son la bouche ouverte, en l’adressant au groupe ; il/elle le répète plusieurs fois pour se donner le temps d’écouter sa voix, de se reconnaître dans sa personne, de sentir la caresse de la vibration dans son corps, d’apprécier la sensation d’espace intérieur et extérieur que ce son lui révèle. On peut changer de son si le premier n’est pas confortable. L’important est de ne rien anticiper en décidant mentalement de ce qu’on veut faire mais de laisser le son venir spontanément, la bouche bien ouverte. Une fois le son terminé, le groupe répond à la personne en faisant le même son, tel un écho. L’objectif est de s’écouter sans se juger ni s’évaluer, d’oser prendre sa place et de se familiariser avec le fait d’être entendu par un groupe (on ne fait pas un son pour soi, comme si on était dans une bulle). L’écho fait également travailler la notion de réceptivité : est-ce que je me laisse réellement toucher par la réponse que le groupe m’adresse ? Cette réponse a souvent un effet très confirmant pour la personne et lui fait sentir son appartenance au groupe. Elle souligne l’importance d’être reconnu d’abord pour qui on est plutôt que pour ce que l’on fait.
Ce genre d’expérience demande d’accorder ensuite du temps pour recueillir les commentaires des uns et des autres.
La conscience de l’espace par l’écoute
Je propose souvent aux élèves, répartis dans la salle, de prendre contact avec l’espace ambiant en restant immobiles, les yeux fermés, et en émettant des sons, un ou deux par expiration ; je privilégie cette simplicité pour rester proche de soi. Comme les sons appartiennent aux 360° de l’espace, on peut très bien appréhender les volumes qui nous entourent en suivant la diffusion de nos sons tout autour de nous. De retour au silence, on se déplace ailleurs et on recommence avec d’autres sons, toujours tous ensemble. On ne recherche pas des consonances ou harmonies musicales particulières avec le groupe. On laisse les sons venir spontanément et on les accueille tels quels, sans les évaluer, les juger ni les analyser. Cette liberté d’esprit permet de se concentrer sur la sensation de l’espace extérieur, sur la sensation de l’espace dont nous disposons à l’intérieur de notre corps, sur notre présence et sur celle des autres autour de nous.
Nous voilà déjà en train d’associer plusieurs éléments dans une écoute globale : « En écoutant les échanges entre l’intérieur de moi et le monde extérieur, je les mets consciemment en relation. Ce geste intérieur me demande de mettre mon écoute en mouvement. En répétant souvent cette expérience, je vais me familiariser progressivement avec l’écoute de l’espace, où qu’il soit : entre moi et les autres, entre moi les murs et le plafond, entre les sons, entre les phrases (on entend souvent dire que la musique est entre les notes), dans le silence. Je vais percevoir l’espace extérieur et tout ce qui l’habite à ma manière, en résonance avec ce monde intérieur qui m’appartient. »
La relation et le phrasé
Le phrasé est toujours présent dans la langue parlée et il se modifie en fonction de l’intention et du sens qu’on lui donne. De la même manière, lorsqu’on aborde la ligne musicale et son articulation dans la relation, par exemple en adressant des sons sans paroles à un interlocuteur, cela engendre un phrasé naturel, varié, non décortiqué par trop d’analyse. Cet éveil est souvent suscité par des paroles : je me rappelle certaines chansons de Jaques-Dalcroze qui me touchaient beaucoup quand j’étais petite et dont je dirais aujourd’hui que c’est mon cœur qui en exprimait spontanément le phrasé.
Sentir le rythme et la pulsation
Tout ce qui prévaut concernant la voix, l’intonation et la qualité d’expression mélodique prévaut aussi pour le rythme et la pulsation. Même si la mise en mouvement du corps aide à la stabilité d’une pulsation ou à la réalisation d’un rythme, l’ajout de la proprioception – qui installe la personne dans son corps – va considérablement participer à intérioriser un tempo ou à donner vie à un rythme.
Quelques ingrédients pour favoriser l’écoute intérieure
Le pouvoir de la simplicité
La simplicité n’est ni vide ni absence. Elle offre au contraire un espace de liberté favorable à l’écoute, à la rencontre et à l’authenticité. Elle génère souvent un foisonnement de sensations de tout ce qui vit entre les sons, de tout ce qui nous relie à nous et au monde. Elle demande de la présence. Limiter les consignes : celles-ci peuvent envahir cet espace et camoufler un manque de présence.
La lenteur et la répétition
On découvre dans le fait de vivre le présent un rapport au temps qui se transforme : ce n’est plus la lenteur synonyme d’ennui qui prévaut, mais la lenteur qui rassemble en un tout les différentes strates de l’être. Répéter un exercice ou refaire une expérience devient un moyen précieux d’inscrire en soi des empreintes vivantes et solides qui génèrent plaisir et confiance.
Il faut éviter d’être pressé. Se donner le temps nécessaire pour que les apprentissages prennent racine dans un terreau bioacoustique et humain vibrant.
La déconstruction
Pour accéder à la simplicité du monde des sensations, nous devons aller dans le sens contraire de ce que nous avons connu : laisser aller le désir de bien faire, et la peur de décevoir, abandonner le réflexe d’apprendre par la volonté, quitter des repères sensoriels de tension (on s’y attache parfois inconsciemment) pour découvrir le plaisir du plus simple, plus confortable, plus vaste et plus précis. Par exemple, le fait de reproduire des sons en chantant DANS le corps, sans réfléchir aux intervalles ni au nom des notes donne une nouvelle perception de soi, une confiance dans sa propre écoute et dans son corps ; c’est une bonne préparation à l’analyse.
En conclusion
Vivre l’écoute et en parler sont deux mondes distincts. Toute théorie ne remplacera jamais le vécu. Il n’y a que l’expérience qui permet de comprendre en profondeur et ainsi de mieux nous connaître. Éveiller la sensibilité, la curiosité et l’élan créateur de l’individu en s’adressant à la globalité de son être lui permet de se révéler dans son expression musicale.
Dalcroze a ouvert une voie large et inspirante dont les nombreux développements sont encore à découvrir et à explorer.
Références
Hiltbrand – Andrade, E. (1990) Louis Hiltbrand (tirage limité) Genève, Suisse
Webpage: Lombard, F. Articles
Lombard, F. Enseigner autrement : une approche basée sur l’écoute (2015) Lombard, F. Chanter juste : l’oreille a un complice (1995)
Lombard, F. La rythmique Dalcroze : une pédagogie en évolution (2018) from http://www.francoise-‐lombard.com
Lombard, F. Dalcroze Eurhythmics, an Evolving Pedagogy Being Music, Dalcroze Canada Fall 2018
Françoise Lombard est musicienne, rythmicienne et pédagogue de l’écoute. Diplômée de l’Institut Jaques-Dalcroze et du Conservatoire de Genève (piano, solfège, harmonie), elle forme d’abord des professeurs de rythmique à Bienne (Suisse). Elle entreprend ensuite une formation en pédagogie de l’écoute (méthode François Louche), discipline qu’elle enseigne en Europe et au Québec aux artistes, instituteurs, éducateurs et thérapeutes. Elle vit à Montréal et partage ses activités professionnelles entre l’écoute, la rythmique et la composition.
Avec Michel Comeau, chanteur et vidéaste, elle crée et réalise 4 CD:
«résonance»
«berceuses/lullabies»
«mon livre à moi»
«blue»
http://www.stareyes-music-education.com